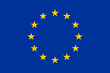Que nous réserve l’avenir? Le futur du développement des vaccins
La recherche sur la vaccination est en constante évolution: elle tire parti des nouvelles technologies pour contribuer à réduire les conséquences de plusieurs maladies ou pour les éliminer complétement de nos communautés.
Depuis la mise au point du premier vaccin en 1796, les scientifiques sont à la recherche de nouveaux moyens de protéger les personnes contre les maladies infectieuses grâce à la vaccination. Si certaines maladies mortelles ou très invalidantes peuvent aujourd’hui être totalement évitées grâce à la vaccination, d’autres, comme le paludisme, continuent de tuer des milliers de personnes dans le monde chaque année. La recherche et le développement de nouveaux vaccins, parallèlement à l’accès aux vaccins existants, restent donc une priorité de santé publique.
Nous disposons désormais de six technologies ou plateformes vaccinales que les chercheurs utilisent pour développer des vaccins. Parmi les avancées les plus prometteuses en matière de technologie vaccinale figurent les vaccins à ARN messager (ARNm) et les vaccins à ADN. Ces solutions peuvent déboucher sur des percées dépassant le domaine des maladies infectieuses, par exemple pour la prévention ou le traitement de certains types de cancer.
Vaccins à ARN messager
La technologie de l’ARN messager (ARNm) fait l’objet d’un développement et de recherches depuis les années 1960. Les premiers essais de vaccins à ARNm ont étudié la façon dont ils pourraient être utilisés dans la prévention du virus Ebola. Dans le contexte de la pandémie liée au SARS-CoV-2, ces efforts initiaux ont été réorientés vers la lutte contre la COVID-19. Le premier vaccin à ARNm autorisé en Europe a été utilisé en 2020 contre la COVID-19.
La technologie de l’ARNm a également été testée lors d’essais cliniques contre d’autres maladies infectieuses, telles que la grippe, le VRS et la maladie à virus Zika.
Depuis les années 1970, on étudie les possibilités offertes par la technologie de l’ARNm afin de mettre au point des vaccins contre certaines formes de cancer, telles que le mélanome et le cancer du poumon, voire d’inventer de nouvelles formes de traitement du cancer. Cette technologie a permis des avancées majeures dans la recherche en aidant à prévenir les récidives de cancers agressifs après une intervention chirurgicale et en apprenant à l’organisme à combattre certains types de cancer avant qu’ils ne puissent se développer.
Vaccins à ADN
Les vaccins à ADN, également connus sous le nom de vaccins plasmidiques, fonctionnent en introduisant dans notre corps de courtes séquences d’ADN contenant les instructions nécessaires à la production d’antigènes d’un virus ou d’une bactérie spécifique. Une fois le vaccin présent dans l’organisme, nos cellules utilisent la séquence d’ADN et commencent à produire ces antigènes. Cela permet à notre système immunitaire d’apprendre à reconnaître et à combattre la maladie si jamais nous y sommes exposés.
L’un des avantages potentiels de cette approche est que la réponse du système immunitaire peut être beaucoup plus forte qu’avec d’autres types de vaccins. Les vaccins à ADN sont également plus stables et plus faciles à produire que les vaccins à ARNm, car ils n’ont pas besoin d’être conservés à des températures très inférieures au point de congélation, ce qui faciliterait considérablement leur distribution.
Le potentiel des vaccins à ADN a été découvert pour la première fois dans les années 1980. Les vaccins à ADN font toujours l’objet de recherches et aucun n’a encore été autorisé pour une utilisation chez l’homme dans l’UE/EEE. Des essais cliniques étudiant leur sécurité et leur efficacité contre plusieurs maladies infectieuses sont en cours dans le monde entier. Les vaccins à ADN ont été utilisés pour la première fois chez l’animal en 1993 et certains ont été autorisés pour cette utilisation aux États-Unis et dans l’UE/EEE. En 2021, l’Inde a autorisé le premier vaccin à ADN destiné à être utilisé chez l’homme pour protéger contre la COVID-19. Les vaccins à ADN peuvent potentiellement permettre un large éventail d’avancées qui ne sont pas disponibles à l’heure actuelle, comme l’obtention d’un vaccin contre le VIH, par exemple.
Comme pour tous les vaccins et autres médicaments en Europe, il devra être démontré que les vaccins à ADN sont sûrs et efficaces avant leur autorisation en vue de leur utilisation chez l’homme.
Nouvelles formes d’administration des vaccins
Bien que les vaccins soient sûrs, efficaces et économiques, les aiguilles peuvent être intimidantes, en particulier pour les enfants. De nombreuses recherches sont en cours sur des façons innovantes d’administrer les vaccins. Quelques exemples sont mentionnés ci-après.